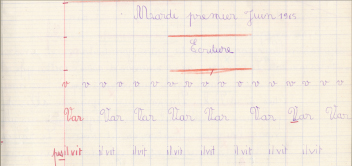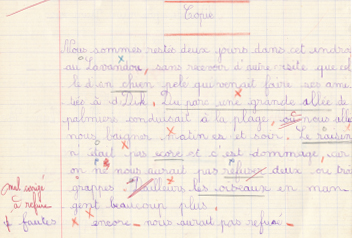L’enfance, est-elle vraiment ce paradis
perdu dont on nous rebat les oreilles ? Pas si sûr. Paradis,
sans doute, parce que fait d’insouciance et de son corollaire, la
naïveté. Et de cette insouciance découle la notion — bien que
relative — de bonheur. Rétrospectivement, nous le savons, avec le
temps, notre esprit ne se focalise plus que sur les bons souvenirs. Les
meilleurs, même, en excluant tout ce peut apporter une ombre au
tableau. Les autres passent à la trappe et l’on s’empresse de les
oublier, comme si tout ce qu’il y avait de fâcheux n’avait jamais
existé. Heureusement, et dans ce cas précis, l’adverbe prend tout son
sens…
En avançant en âge — en tout cas lorsqu’on
a cette chance —, les scènes, anciennes, éparses ou fragmentaires,
ne se singularisent plus et finissent par se diluer. À tel point que ce
sont toujours les mêmes souvenirs que l’on s’ingénie à ressasser
jusqu’à les embellir par la force des choses, à moins qu’un événement
singulier — un objet, une photo, une lettre, que
sais-je ! — nous permette de tirer un fil puis de le dérouler
en faisant brusquement resurgir la trame d’actions enfouies qu’on
croyait à jamais disparues, évaporées dans les circonvolutions de notre
cerveau.
Parfois, au-delà du souvenir en soi flotte quelque
chose d’indéfinissable : son regard d’alors, l’ingénuité dont on
faisait preuve à l’approche d’un fait, avec une perception identique à
celle qu’on avait des autres et du monde en général : un plongeon
dans une époque révolue, génératrice d’une forte émotion, à la frange
du rêve et d’une réalité dépassée. Le plus souvent, il ne s’agit là que
d’impressions fugaces, mais suffisamment éloquentes pour que l’on en
éprouve un plaisir mêlé de mélancolie. C’est à cette fin, du reste,
qu’il m’est arrivé de reprendre un de ces bouquins que je dévorais
entre six à dix ans ; non pour l’intrigue, bien entendu, mais pour
retrouver à travers les phrases les sentiments que j’éprouvais à leur
découverte, comme une bouffée d’air frais.
Ne nous voilons pas la face : prosaïquement,
l’enfance n’est qu’un paradis relatif, comme le peuvent l’être d’autres
souvenirs plus tardifs. La différence réside dans l’impression que l’on
éprouve au moment des faits : le maître mot, c’est toujours
l’insouciance et son cortège familier d’innocence ou d’ignorance, qui
par voie de conséquence nous mène à cette naïveté du présent, car sans
préoccupation du lendemain. Ne perdons pas de vue que si ce
« paradis » était composé de rares moments de joie
intense, ces moments n’en demeuraient pas moins des pointillés épars au
fil d’une succession de contraintes dont on a perdu la notion. Mais
pour brefs qu’ils fussent, ces instants-là se sont suffi à eux-mêmes au
point de se maintenir vivaces plusieurs décennies plus tard. Tout au
long de nos jeunes années, c’est donc cette insouciance qui nous guide
et qu’on ne réalise qu’après, bien plus tard, avec le recul et
l’expérience que l’existence nous octroie. C’est elle aussi que l’on
envie à travers ce qui subsiste de ce qu’on croit être nous.
« Déjà, le 1er juin ! » m’étais-je
exclamé. Nous étions en 1965 et j’avais alors sept ans. À l’heure où je
rédige ces quelques lignes, nous sommes le 1er juin 2021, soit quelque
56 ans plus tard. Pourquoi se remémorer ces mots ? Pourquoi
ceux-là ? Je l’ignore. À sept ans, la notion de durée est encore
confuse et les journées vont si lentement qu’une semaine nous paraît
une éternité. Brusquement, on réalise que c’est l’été, puis la promesse
de longues vacances, notions nullement anticipées du fait qu’on ne se
pose pas la question l’après : fataliste, on vit sans la moindre
anticipation, et le seul fait de recopier la date marquée au tableau
sur son cahier d’écolier nous emmène à une subite prise de conscience
et nous fait peut-être entrevoir les tracas de l’existence à venir.
Je ne sais pourquoi, chaque fois que j’arrive à la
date susdite, je me souviens de ces mots prononcés ce matin-là sous
l’effet de la surprise en constatant la marche du temps. Un peu comme
une date anniversaire, je n’ai cessé chaque année d’y penser. Et voilà
que par un curieux hasard, j’ai retrouvé par le fond d’un tiroir, le
vieux cahier du jour où figurait cette date. Nous étions un mardi. Et
après m’être exclamé à haute voix, j’ai dû m’empresser de tremper mon
porte-plume dans l’encre violette pour faire mes lignes d’écriture en
respectant le modèle. Et je le suppose en le mordillant dès qu’une idée
confuse venait altérer ma concentration.
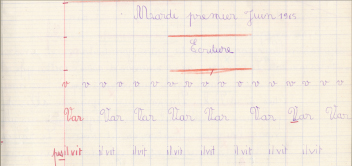
Bien qu’il ne m’en reste naturellement aucune
réminiscence de jour-là, après un petit problème sur la multiplication
(où la boîte de sardines coûtait 1 F 25, s’il vous plaît !) ce
même cahier d’exercices me renvoie à un exercice autrement plus
complexe appelé « copie de mémoire » : un extrait d’un livre de
lecture, un paragraphe à apprendre par cœur la veille et à ressortir de
tête et de préférence sans fautes le lendemain…
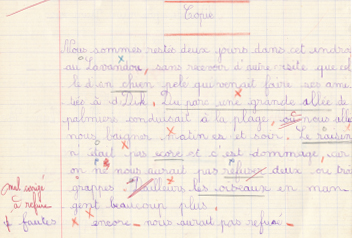
Suivait une petite dictée d’un huitaine de
lignes sur l’accord entre l’adjectif et le nom. Et encore ne
s’agissait-il que du cahier d’exercices ! Je ferme la parenthèse…
Pour en revenir à mon propos initial, l’oubli pose
une chape de plomb sur la mémoire : en se focalisant sur de vagues
réminiscences — et rien que sur elles — une
extrapolation se met en place, enrichissant et valorisant des souvenirs
singuliers au détriment d’autres, appelés à plus ou moins court terme à
disparaître. De la sorte, certaines fonctions cognitives qui
enrichissent prétendument notre conscience se basent non sur la
réalité, mais sur une perception déformée, altérée et évidemment
embellie de cette même réalité.
Bien entendu, la différence entre les individus fait
qu’il est probable que ces constatations fluctuent en fonction du vécu
et de la personnalité de chacun ; néanmoins, je reste
persuadé que cette différence est mineure et que ce qui est valable
pour l’un demeure globalement valable pour les autres. Ainsi se
construit notre existence au travers de nombreux détours où quelques
points d’appui permettent d’éprouver la solidité du bâti.
Avons-nous les souvenirs que nous méritons, comme
l’écrivait Gérard Bauër ? Possible ; en tout cas, c’est
l’aveu implicite de la distorsion de ceux-ci dans notre imaginaire.
Probable aussi que se teinte de regrets chaque évocation d’un
« paradis perdu », lequel se prolongerait par l’émotion d’un
bref retour à notre âme d’enfant après laquelle on court sans cesse
afin de se vouloir libre et de bien vieillir ; un regard neuf et
délivré de toute allégeance à un quelconque parti pris :
Les grands enfants n’ont pas le
rire fêlé
De leurs ternes cousins, graves
et besogneux,
Par les chemins de sagesse,
isolés,
Ils se sont égarés, légers,
insoucieux,
Les grands enfants…
Les grands enfants s’échappent
du réel ;
Pourchassant l’éphémère, ils se
sont libérés
Des servitudes du conventionnel,
Enthousiasmés qu’ils sont en
leur jardin secret,
Les grands enfants…
Ont-ils un jour eu si peur de
grandir ?
Les grands enfants n’ont pas
cédé à l’érosion
De jours bornés à ne pas
s’abêtir :
Leur quotidien s’affirme en
leur soif d’évasion,
Les grands enfants…
Aussi vont-ils, encore purs et
confiants :
La terre est généreuse à leur
âme d’enfant.
Libres, aériens, ils vont
s’émerveillant,
Leur paradis perdu ne l’est
jamais vraiment,
Les grands enfants…
Bien affermis dans leur
ténacité,
Brûlant mille chimères au feu
de leur ardeur,
Malgré le sort, ceux-là ont
résisté,
Tout acharnés qu’ils sont,
obstinés et frondeurs,
Les grands enfants…
© Jacques Goudeaux
Il n’y a rien d’étonnant à garder son âme
d’enfant ; la plupart des adultes — je parle de ceux qui
savent encore s’étonner pour un rien, ils sont peut-être les plus
nombreux ! — même à un âge avancé conservent cette façon
d’appréhender le monde par d’éternelles nouveautés. Le copain Louis,
authentique chevrier de Virgile, comme aurait dit Pagnol, à plus de
quatre-vingt-dix ans prenait le temps de s’étonner de la beauté d’une
fleur ou de s’extasier devant un paysage moult fois contemplé. Ajoutons
à cela une curiosité naturelle qui allie l’enthousiasme au sens de la
découverte. Et les choses futiles — du moins considérées
comme telles — prennent alors une importance considérable, car
leurs yeux remarquent ces détails que le profane ne peut saisir et
comprendre encore moins.
« Nous avançons
devisant ferme, parfois le regard accroché aux flancs de la montagne
éclairés par places de la verdure tendre des feuilles à peine
défroissées, le plus souvent à terre ou au bord du fossé pour y
chercher l’extraordinaire, invisible au profane. Tiens ! Justement sur
le talus, à l’abri des pins, dans une nappe de mousse sombre, une
nichée de violettes : fantaisie de dame Nature, celles-ci,
contrairement à leurs petites sœurs de la vallée, dressées sur une tige
élancée, déploient avec élégance de larges pétales à l’exceptionnelle
luminosité. Du haut de leur petite taille, les belles semblent défier
le promeneur et lui dire : « Ne voyez-vous pas comme nous sommes jolies
? » Pauvrettes ! Combien d’entre eux sont-ils passés à un mètre à peine
et sans leur accorder la moindre attention… »
© Jacques Goudeaux